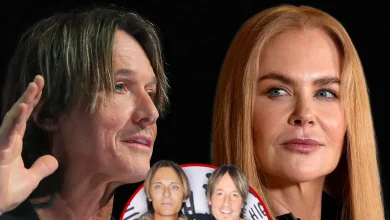Droits de douane | Les juges qui diront non à Trump
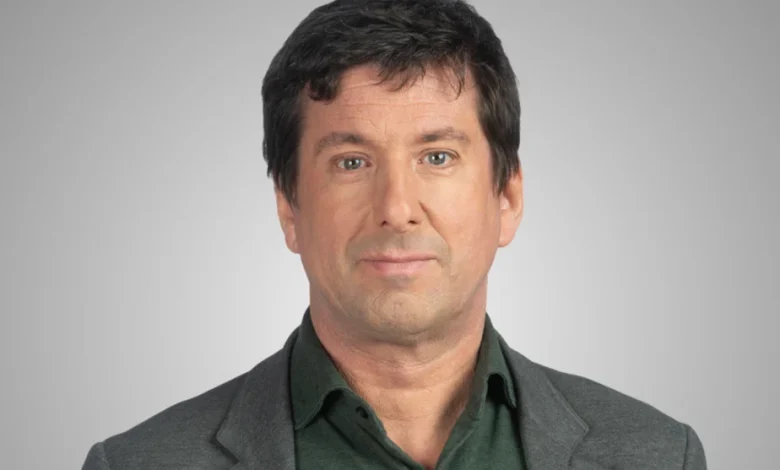
Jusqu’où vont les pouvoirs d’un président d’imposer des droits de douane ? Il n’y a pas de limite, dit Donald Trump.
Publié à 6 h 00
Mais le dernier mot appartient à la Cour suprême. Et à entendre les questions et le ton sur lequel elles étaient posées par les neuf juges mercredi, on peut penser que cette Maison-Blanche va se faire rappeler à l’ordre. Au moins cinq des neuf juges ont paru très critiques de la théorie du président.
Car une audience à la Cour suprême américaine n’est pas une série de longues plaidoiries. Les procureurs plaident très brièvement et ensuite répondent aux questions bombardées par les juges. On voit tout de suite ce qui accroche dans l’esprit de chaque juge.
ILLUSTRATION DANA VERKOUTEREN, ASSOCIATED PRESS
Les neuf juges de la Cour suprême qui doivent se prononcer sur les droits de douane : Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, le président John Roberts, Samuel Alito, Elena Kagan, Brett Kavanaugh et Ketanji Brown Jackson
Or, ce qui accroche, c’est que les droits de douane sont des taxes. Or, selon la Constitution, seul le Congrès peut lever des taxes. L’administration Trump plaide une loi de 1977 donnant des pouvoirs d’urgence au président pour répondre à « une menace inhabituelle et extraordinaire », à la sécurité nationale, la politique étrangère ou l’économie.
PHOTO MARIAM ZUHAIB, ASSOCIATED PRESS
« On aime notre État de droit », peut-on lire sur la pancarte de cette manifestante devant la Cour suprême, mercredi.
Cette loi a déjà été utilisée par d’autres présidents pour empêcher les produits de certains pays d’entrer aux États-Unis. Ou imposer des sanctions économiques à des pays voyous. Mais nulle part dans la loi le mot tariff n’apparaît. Or, pour déléguer un pouvoir aussi important, il faut des termes explicites, disent des commerçants et des États américains.
Déjà, les deux paliers judiciaires inférieurs ont conclu à l’illégalité de ces droits de douane de 10 % décrétés sur les biens venant de plus de 100 pays en avril – et de toutes les variations par pays, changeant au gré des humeurs du président.
Trump dit que c’est une question « DE VIE OU DE MORT pour le pays ». Ce n’est évidemment pas le cas. Mais l’annulation de ces droits serait un coup énorme à son autorité. Faudrait-il rembourser les milliards de droits perçus ? S’ils sont nuls, en principe, il faudrait le faire. Qu’en est-il des traités signés sous la menace de droits de douane ?
Bref, les conséquences politiques et commerciales seraient majeures. Trump avait dit qu’il se rendrait lui-même écouter la cause. Il a plutôt délégué ses secrétaires au Trésor, Scott Bessent, et au Commerce, Howard Lutnick, assis aux premières loges dans la salle d’audience, comme un avertissement…
Cette cause n’est que la première d’une série qui permettra à la Cour de dessiner les contours du pouvoir présidentiel. Trump a beau ne ressembler à aucun autre président, ce n’est évidemment pas la première fois que le sujet est débattu.
Car Donald Trump n’est pas le premier président à signer des décrets à la pelle.
Pendant ses quatre mandats, Franklin Delano Roosevelt a été l’auteur de 3721 décrets. La plupart visaient à répondre à la crise économique des années 1930, puis à la Seconde Guerre mondiale avec la première génération de mesures « sociales-démocrates ».
Très rapidement, les politiques sociales de FDR ont été attaquées par le monde des affaires. La Cour suprême des États-Unis, dans une série de jugements célèbres, a invalidé plusieurs de ses initiatives. Les juges estimaient qu’il avait usurpé les pouvoirs du Congrès.
FDR était tellement furieux qu’il a menacé d’augmenter le nombre de juges à la Cour suprême, pour noyer la majorité conservatrice.
À l’époque, les juges avaient eu recours à la théorie de la « non-délégation » pour invalider les lois sociales : le Congrès ne peut abdiquer ses pouvoirs constitutionnels au président. Ce serait comme récrire la Constitution.
Ces jugements ont été durement critiqués par les juristes progressistes. Mais 100 ans plus tard… ce sont les adversaires de Trump qui invoquent ces précédents jugés rétrogrades.
Le juge Samuel Alito, chef de file de l’aile conservatrice, a souligné l’ironie à l’avocat des commerçants, Neal Katyal.
PHOTO NATHAN HOWARD, REUTERS
L’avocat des commerçants, Neal Katyal
« Je me demande si vous avez réfléchi au fait que votre héritage comme avocat constitutionnaliste sera d’être l’homme ayant ressuscité l’argument de la non-délégation », a-t-il dit en riant.
En effet, a répondu le procureur, mais ici, ce n’est plus de la délégation, c’est de l’abrogation. Le président a carrément usurpé le pouvoir du Congrès. « De toute manière, notre argument n’est pas qu’on ne peut pas déléguer les pouvoirs en matière de tarifs, mais qu’on doit le faire de manière explicite », plaide Katyal.
À l’inverse, on oppose à Trump l’argument ayant permis d’annuler des politiques de Joe Biden. La théorie des « grandes questions » : quand une politique économique a des impacts majeurs, il faut une autorisation claire du Congrès – ce que Biden n’avait pas pour les prêts étudiants, selon la Cour. Les droits de douane sont clairement une « grande question ».
Comme on voit, on n’aime pas les pouvoirs excessifs du président… quand il est du parti adverse.
La Maison-Blanche n’est pas sans argument. Pourquoi le président pourrait-il empêcher des biens d’entrer au pays, mais ne pourrait pas prendre une mesure moins radicale en imposant des droits de douane, même minuscules ? À cela, la réponse est que dès qu’il y a prélèvement d’argent, c’est une taxe. Et cela est du ressort du Congrès.
Pour John Sauer, l’avocat de Trump devenu solliciteur général du pays, les droits ne sont pas forcément perçus : c’est un levier, un outil de négociation pour ramener au pays les industries. Si les biens sont produits aux États-Unis, il n’y aura aucun argent perçu…
L’annulation de ces droits plongerait le pays dans une dépression.
Mais même le juge conservateur Neil Gorsuch était mal à l’aise avec l’idée qu’on puisse déléguer un pouvoir aussi important. « Si le Congrès disait au président : on en a marre de faire les lois, faites-les, ce serait permis ? »
Même si les opposants aux droits de douane gagnent, le président conserve le droit d’en imposer pour des industries ciblées, comme l’aluminium, l’acier et le bois d’œuvre. Ce ne sera pas la fin des « tarifs ».
Mais ce serait le signal clair que cette Cour, qui a élargi l’immunité criminelle du président de manière historique l’an dernier, n’est pas soumise à Donald Trump comme on l’a présumé. Combien des neuf diront non à Trump ? Il en faut cinq…