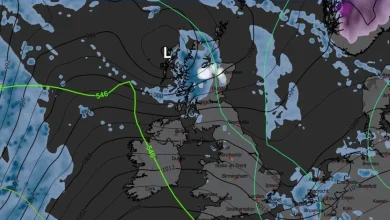Jour J pour le REM 2.0

J’ai vu la lumière au bout du tunnel. Et, non : ce n’est pas une métaphore.
Publié à 5 h 00
Nous étions à mi-chemin d’un long tube de 4 kilomètres, entre les gratte-ciel du centre-ville et les maisons cossues de Mont-Royal, quand les premiers faisceaux se sont profilés. Un tout petit cercle lumineux, à l’horizon.
Pour être plus précis, nous étions sous le mont Royal, à la hauteur de l’Université de Montréal.
Deux minutes plus tard, après une traversée à près de 100 km/h, nous sortions des entrailles de la montagne pour aboutir à la gare Canora, dans la proche banlieue de Mont-Royal. À l’une des 14 stations du Réseau express métropolitain (REM) qui seront inaugurées ce vendredi.
Charles Emond, le grand patron de La Caisse, m’a offert une première visite de la nouvelle antenne de ce système de train léger automatisé.
PHOTO EDOUARD DESROCHES, COLLABORATION SPÉCIALE
Charles Emond et Maxime Bergeron discutent dans le nouveau tronçon du REM passant sous le mont Royal.
Ce sera un moment charnière dans la jeune histoire de ce projet conçu en 2016, et lancé en 2018 par l’institution qui se nommait alors Caisse de dépôt et placement du Québec.
Car la trajectoire du REM, jusqu’ici, a été parsemée d’embûches. Des explosifs ont été découverts dans le tunnel centenaire sous le mont Royal. La pandémie a frappé. Des sous-traitants de La Caisse se sont disputés devant les tribunaux, ce qui inclut une poursuite de 137 millions1. Les délais se sont multipliés.
Et surtout : la première branche entre Brossard et le centre-ville, inaugurée à l’été 2023, a été plombée par des dizaines de pannes. La déficience de plusieurs équipements et une communication médiocre ont fragilisé la confiance des usagers.
Pour La Caisse, cette nouvelle antenne vers Deux-Montagnes représentera une deuxième chance de faire bonne impression.
Le défi de séduction sera à la hauteur de la transformation promise par ce nouveau réseau. C’est-à-dire : gigantesque. « En sept ou huit ans, on viendra doubler l’envergure du métro, c’est immense comme histoire », m’a fait valoir Charles Emond, pendant notre traversée sous le mont Royal.
Il dit vrai.
Le métro de Montréal compte 68 stations réparties sur 69 kilomètres. Elles sont en majorité situées dans l’île, à part un saut de puce à Longueuil et trois stations à Laval.
Une fois complété en 2027, si les astres s’alignent, le REM totalisera 67 kilomètres. Il comptera 26 stations, disséminées entre la Rive-Sud, le centre et le nord-ouest de l’île, l’aéroport de Dorval, puis Laval et Deux-Montagnes, en banlieue nord.
Mais déjà, l’antenne inaugurée ce vendredi devant des dignitaires changera le profil de la mobilité à Montréal.
De façon majeure.
C’est avec ce tronçon que le REM s’imbriquera vraiment au réseau de transport existant de la métropole, ce qui n’était pas prévu dans sa première mouture. Ces connexions avec le métro, un gain arraché à La Caisse, seront la clé de voûte du projet, selon moi.
Il y aura des connexions avec la ligne orange du métro (station Bonaventure), la ligne verte (McGill), la ligne bleue (Édouard-Montpetit), puis le train de banlieue de Mascouche (Côte-de-Liesse).
La fréquence du REM, qui passera toutes les deux minutes et demie en pointe et toutes les cinq minutes le reste du temps, en fera l’équivalent d’un métro hors-sol, sauf pour la partie enfouie sous le mont Royal. On pourra se rendre du centre-ville jusqu’à l’Université de Montréal en cinq minutes, un trajet qui prend au moins une demi-heure aujourd’hui.
Quelque 50 kilomètres du réseau seront en activité dès ce vendredi, avec 19 stations. Charles Emond y voit un « accomplissement extraordinaire » en matière d’ingénierie, réalisé pour environ la moitié du coût de projets similaires ailleurs dans le monde, à une vitesse somme toute appréciable.
Ce projet-là est à 125 millions du kilomètre, alors que les projets comparables se font pour le double, ou même 60 à 70 % plus cher, ailleurs. Ça montre qu’on est capables de bâtir ici des affaires qui marchent, de classe mondiale, pour moins cher qu’ailleurs.
Charles Emond, président et chef de la direction de La Caisse
La Caisse évalue le coût global du REM à 8,3 milliards, au-delà des 7 milliards prévus à l’origine. La vérificatrice générale du Québec évalue plutôt la facture totale à 9,4 milliards.
Dans les deux cas, cela reste en effet moins cher que la majorité des projets similaires. Par exemple la construction de ligne de train léger Eglinton, à Toronto, qui s’étire depuis 14 ans. Son coût a explosé de 5 à 13 milliards, pour 19 kilomètres2.
Quand on se compare…
La confiance devra être bâtie, ou rebâtie, avec les futurs usagers du REM. Charles Emond en est très bien conscient. Tout ne sera pas parfait dans les premiers temps, avertit-il.
Il va toujours y en avoir, des pannes. C’est un système en rodage qui s’en vient, on multiplie par trois le nombre de kilomètres. Demain, on passe de 17 à 50 km, on multiplie par quatre le nombre de stations, c’est quand même gros.
Charles Emond, président et chef de la direction de La Caisse
Le patron de La Caisse assure que des leçons ont été tirées des déboires de la première antenne sur la Rive-Sud. Plusieurs systèmes ont été modifiés sur les trains d’Alstom, construits en Inde. Des directives sévères ont aussi été imposées au consortium qui exploite le REM, en sous-traitance pour La Caisse, composé d’Alstom et d’AtkinsRéalis.
PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE
La station Bois-Franc de la deuxième phase du REM, située dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal
« Ils ont fait des tests, puis ils ont des plans pour tout ce qui concerne le système de freinage hivernal, explique-t-il. Et ils ont remplacé les équipements, les aiguillages qui avaient eu des enjeux l’hiver dernier. »
Le consortium, qui emploie 800 personnes, vient de se renommer Pulsar. Une tentative de faire peau neuve dans l’image publique, sans aucun doute.
Il y a eu bien des retards, des controverses et des dépassements de coûts avec le REM. Son modèle financier, qui lui assure une desserte exclusive en vertu d’une entente renouvelable de 99 ans avec Québec, a souvent été critiqué, y compris par moi.
PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE
L’entrée de la station Bois-Franc, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal
Mais ce qui est fait est fait. Il faut regarder vers l’avant.
Et dans le contexte morose du transport collectif, avec une grève de deux jours qui s’annonce ce week-end à la Société de transport de Montréal (STM), l’arrivée de ce nouveau réseau est une excellente nouvelle.
Le REM 2.0 rencontrera des écueils, sans aucun doute. Mais il entraînera aussi de vastes bénéfices, comme la construction prévue de 20 000 logements autour des futures stations. Il suffit de regarder le boom survenu à Brossard pour comprendre l’impact d’un tel réseau structurant.
Et si les usagers adoptent le REM, il y aura des milliers d’automobilistes en moins coincés dans le trafic. Un bénéfice non négligeable.
Le nouveau tronçon du REM sera ouvert au public samedi et dimanche de 9 h à 18 h et sera officiellement mis en service lundi.
1. Lisez l’article « Le REM au cœur d’une poursuite de 137 millions »
2. Lisez l’article du Globe and Mail « How the Eglinton Crosstown LRT went so wrong, for so long » (en anglais ; abonnement requis)