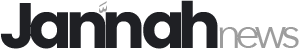Des chauffeurs d’autobus «fatigués» par leurs conditions de travail

Alors qu’une deuxième grève des chauffeurs d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) se dessine pour les 15 et 16 novembre prochains, ces derniers déplorent faire face à une perception du public « encore négative ». Ils décrivent aussi des conditions de travail qu’ils jugent difficiles. Le Devoir est allé à leur rencontre pendant que tous les yeux sont tournés vers leur conflit de travail.
« Je ne sais même pas à quelle heure je commence demain », raconte Alexandre (nom fictif), un chauffeur d’autobus qui travaille à la STM depuis un peu plus d’un an. Comme les chauffeurs n’ont pas le droit de s’adresser aux médias en raison des négociations en cours, les cinq employés interviewés ont demandé l’anonymat. Au total, une dizaine de chauffeurs furent interpellés.
« C’est fatigant, je suis fatigué », poursuit le chauffeur, rencontré en début d’après-midi. Ce n’est qu’aux alentours de 16 h 30 qu’il va connaître son horaire pour le lendemain.
Pour Alexandre, c’est tout particulièrement les questions d’horaire qui le dérangent. « Le salaire, le fonds de pension, ça va. Mais quand je vois l’horaire qu’on me donne, j’ai envie de revenir à mon ancien emploi », admet le jeune chauffeur. En plus des heures de début et de fin qui sont variables en raison de sa faible ancienneté, il doit être disponible pendant environ 12 heures par jour, mais il n’est payé que pour 7 : chaque jour, son quart est séparé en deux par une période de trois à quatre heures où il doit se déplacer entre deux garages sur l’île de Montréal. Durant cette période où il « ne peut rien faire », Alexandre est payé 15 % de son salaire.
Des conditions ardues, selon les chauffeurs
« On pourrait mieux organiser notre temps », indique-t-il en donnant l’exemple d’une journée où il doit « faire trois lignes », donc conduire trois bus différents. Et ces « lignes » ne sont pas toujours les mêmes, ce qui le force à bien connaître le réseau de bus de la métropole sans nécessairement l’avoir déjà emprunté.
« Quand je commençais, j’allais faire le trajet avec ma voiture pendant mon temps personnel. Sans ça, j’aurais été perdu. Les usagers s’attendent de nous que l’on connaisse le trajet », admet-il.
Ces conditions de travail en début d’emploi, où « il faut travailler cinq ans avant d’avoir une vraie fin de semaine », souligne Alexandre, représente l’une des principales difficultés de rétention du personnel, selon tous les chauffeurs rencontrés par Le Devoir, qui ont notamment mentionné le faible taux d’employés qui finissent la formation. « Ils nous disent rapidement que c’est vraiment compliqué », raconte Alexandre, qui souligne que la moitié de sa cohorte a démissionné avant la fin de la formation.
« Tous ceux qui ont mon âge, on tough en attendant juste de voir de quoi va avoir l’air la convention collective pour décider si on part ou reste », dit pour sa part Joseph, qui conduit des bus depuis une vingtaine d’années. « J’ai bientôt 60 ans et, dès que je les ai, je peux partir sans pénalité. À partir de là, ça va être un mois à la fois. »
Le chauffeur d’expérience se dit particulièrement heurté par la perception publique voulant que ses collègues et lui soient bien payés. « Oui, je peux faire 100 000 $ ou plus [comme plusieurs médias l’ont rapporté], mais, pour ça, il faut que j’enchaîne les heures supplémentaires, que je fasse 12-15 heures par jour », lance-t-il. « Je suis claqué. Comment veux-tu avoir une vie de famille avec des conditions comme ça ? »
Pour Joseph s’ajoute aux longues heures de travail le sentiment de ne pas être valorisé par le public. « Je me fais engueuler quasiment chaque jour », raconte-t-il. « Tout est une complainte envers nous, c’est nous [que le public] voit », déplore-t-il.
« On veut juste un peu de respect »
Constat similaire pour Martin, qui n’a plus que l’amour du métier pour le motiver à garder son emploi. « J’ai droit à ma pension. Je fais ça parce que j’aime ça, j’adore ça. Mais les conditions ne sont pas adéquates : on n’a pas de temps à la fin de nos lignes, même pas pour aller à la toilette », dénonce celui qui a accumulé une trentaine d’années d’expérience à la STM. Selon lui, un meilleur financement gouvernemental du transport en commun pourrait aider à dénouer les impasses entre les syndicats et la partie patronale.
« On veut juste un peu de respect », affirme-t-il, en écho à son collègue Joseph. Depuis le début de la grève de novembre des employés d’entretien de la STM, qui a pris fin mercredi matin, Martin observe une hausse de la violence verbale des usagers envers les chauffeurs.
Il dit d’ailleurs « espérer » que les chauffeurs n’auront pas à aller jusqu’à la grève de samedi et dimanche prochains. « Mais, d’après moi, on va la faire [la grève], on est vraiment rendus au bout, dit-il en soupirant. Faut que [la STM] arrête de nous prendre pour des esclaves. »
« Ça m’arrange de rouler à longueur de journée », renchérit Joseph en référence à la fin de la grève des employés d’entretien, qui limitait le service aux heures de pointe. « [La grève], ce n’est pas agréable pour personne. On est très empathiques là-dessus », mentionne-t-il.
« Tu sais, notre job, elle n’est pas parfaite. Mais il y en a-tu, une job, dans la vie, qui est parfaite ? On essaie juste de pédaler dans l’imperfection », relève le chauffeur.
Dans un communiqué diffusé jeudi, le syndicat des chauffeurs de bus a affirmé être « pas loin d’une entente ». Du côté de la STM, on se garde de dévoiler les détails des négociations, affirmant uniquement qu’il n’est pas question d’accepter les demandes du syndicat si elles sortent du cadre financier. L’optique d’une intervention gouvernementale consistant à avancer l’entrée en vigueur de la loi 14 pour empêcher la grève semble également écartée, comme le premier ministre François Legault a affirmé ne pas vouloir avoir recours au bâillon dans ce dossier.