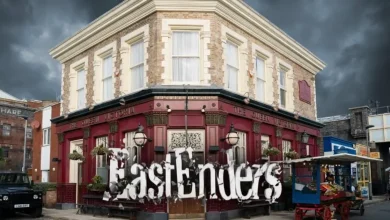A quel prix la Grèce rembourse-t-elle les milliards prêtés par la France ?

La Grèce a changé. Finies les critiques sur sa dette publique abyssale, qui l’avait contrainte à solliciter l’aide du Fonds monétaire international et de l’Union européenne en 2010. Finies la charge des pays européens contre Athènes, Berlin en tête, avec le « pas un euro pour les Grecs ! » lancé par la chancelière allemande Angela Merkel en 2010.
En 2025, la Grèce reste le pays le plus endetté d’Europe, à 151,2 % du PIB, quand la dette publique française est à 115,8 % du PIB. Mais son taux de croissance élevé et une très stricte rigueur budgétaire offrent à la République hellénique des milliards d’euros de solde budgétaire primaire, ce qui lui permet de rembourser ses créanciers par anticipation. Cette année, le pays a versé à la France 1,1 milliard d’euros, après 1,7 milliard d’euros en 2024, alors que ses remboursements devaient initialement s’étaler entre 2033 et 2041. Une aide financière bienvenue pour Paris, en pleine crise de la dette publique.
Des chiffres « qui ravissent les créanciers et les institutions nationales »
« Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis publie des chiffres qui ravissent les créanciers et les institutions internationales. Et il prend un certain plaisir à montrer qu’il peut rembourser en avance, et ainsi affirmer que sa politique réussit », réagit Joëlle Dalègre, maître de conférences émérite à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), spécialiste de la Grèce moderne.
La baisse spectaculaire des déficits publics est le fruit de politiques prises durant la crise. « La Grèce a appris à ramasser l’impôt, ce que les gouvernements précédents faisaient très mal. Les impôts ont été augmentés, et de nouveaux ont été créés, rappelle Joëlle Dalègre. De plus, de nombreuses privatisations ont eu lieu. » De l’autre côté, les dépenses publiques ont fortement diminué : « Cela s’est traduit par une baisse des salaires des fonctionnaires de 30 %, leur 13e mois a été supprimé, ainsi que leur prime à Pâques. Tous les droits sociaux, relevant du travail ou de la grève, ont été revus au nom de la flexibilité. » Du coté des retraites, ajoute la spécialiste de la Grèce, « elles ont diminué entre 20 % et 40 %, avec un départ à la retraite à 67 ans pour avoir toutes ses cotisations. Et la Sécurité sociale a diminué de près de trois quarts depuis 2010. »
Ce qui fait dire à Joëlle Dalègre : « Si les finances publiques vont beaucoup mieux, je ne crois pas que l’économie grecque soit aujourd’hui en grande forme. Elle repose très fortement sur le développement du tourisme international, avec les problèmes que cela entraîne sur la mobilisation des ressources et les conséquences environnementales. »
Grèves sur le coût de la vie et les horaires à rallonge
Le satisfecit des autorités sur les finances publiques résonne différemment aux oreilles des Grecs. La grève du 9 avril dernier, pour des hausses de salaires et des mesures face à l’inflation et la crise du logement, a été très suivie. Et le mécontentement a repris en octobre, après l’adoption d’une loi autorisant les employeurs du secteur privé à étendre la journée de travail jusqu’à 13 heures. Deux nouvelles grèves générales ont été alors organisées.
« L’austérité n’est absolument pas terminée en Grèce. Les Grecs gagnent toujours moins qu’avant 2010 alors que l’inflation a bondi, relève Joëlle Dalègre. Le pouvoir d’achat des Grecs est, dans les faits, proche de celui des Bulgares, le plus bas d’Europe. Une génération de Grecs ne connaît que l’austérité, et une partie de la jeunesse, de ses cerveaux, elle, a fui ».
Notre dossier Grèce
Un rapport du Comité européen des droits sociaux (European Committee of Social Rights) de 2025 critique la réponse grecque à la crise, évoquant des mesures souvent temporaires, par des primes, à destination des plus modestes. Quant au taux de pauvreté, il était, en 2023, de 19,6 % en Grèce, contre 15,9 % en France selon l’Institut national de la statistique (Insee). Pour redresser ses comptes publics, « sur la logique purement financière, la méthode grecque est mathématiquement efficace, souligne Joëlle Dalègre. Mais le prix social est très cher à payer ».