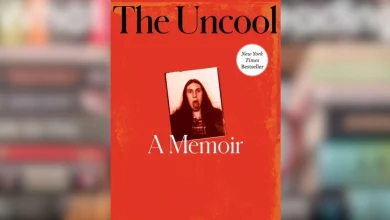Braconnage en recul mais difficultés post-Chido, Oulanga Na Nyamba et son savoir-faire menacés

GPS en main, François-Elie Paute tente de retrouver le chemin qui mène à la plage, enfoui entre la forêt et les plantations de bananiers, quelque part entre la baie d’Acoua et le village de Mliha. Il est environ 9 h 30, ce mardi 18 novembre, et la chaleur déjà lourde se mêle à une humidité étouffante, à peine tempérée par une brise venue du lagon que l’on aperçoit par intermittence entre les branches.
L’accès difficile aux sites de ponte ne freine malheureusement pas les braconniers
Responsable du pôle connaissance au sein de l’association Oulanga Na Nyamba, référence locale dans la protection et la recherche scientifique sur les tortues marines, il se rend tous les deux mois sur les sites de ponte les plus isolés du nord de Grande-Terre pour suivre l’évolution du braconnage. Depuis le passage du cyclone Chido et avec une activité agricole importante, la zone est en perpétuelle évolution, tantôt bouchée par les branchages, tantôt dégagée par les zones de brûlis, et il est difficile de se repérer.
Après une vingtaine de minutes de marche, le front perlé de sueur et les pas posés avec prudence sur un sol glissant, la plage d’Apondra se révèle enfin : un ruban de sable clair parsemé de rochers noirs et arrondis, polis par les marées. La mission peut désormais commencer.
Le braconnage en diminution
« Ouvrez bien vos yeux et vos narines », lance François-Elie aux trois jeunes hommes de l’association Le Regard du cœur, venus se former à la surveillance du braconnage et approfondir leurs connaissances sur les tortues marines. À peine quelques mètres parcourus que les premières carapaces vides apparaissent, disséminées çà et là, abandonnées par les braconniers. Certaines portent un point de peinture rouge ou bleu : un marquage réalisé lors d’un précédent passage par Oulanga Na Nyamba, indiquant qu’elles ont déjà été recensées et ne témoignent pas d’un acte récent.
Selon François-Elie, les actions menées ces dernières années dans le cadre du Plan Tortue ont permis de réduire le braconnage.
« Après Chido, on craignait une reprise du braconnage, un peu comme pendant la période du Covid-19, quand certaines personnes tuaient les tortues pour se nourrir. Mais ce n’est pas ce qui s’est produit », explique François-Elie qui évalue le nombre de tortues braconnées à 200/300 par an. « La situation reste plutôt calme depuis plusieurs mois. Cela tient en grande partie au travail conséquent des forces de l’ordre et aux arrestations de plusieurs braconniers, dont l’un des plus actifs de Mayotte, est aujourd’hui en prison. En parallèle, nous nous constituons partie civile dans les procès depuis huit ans et nous sensibilisons le grand public, les magistrats et les différentes forces de police. Tous ces efforts combinés portent leurs fruits. Mais nous restons vigilants, et c’est pour cette raison que nous continuons ces sorties régulières : pour observer, anticiper et réagir si le braconnage venait à reprendre ».
En plus des carapaces et autres indices de braconnage, François-Elie, Hicham, Ben-Abdallah et Makdouri recherchent aussi les traces laissées par les tortues venues pondre sur la plage. L’objectif est de vérifier que l’animal est bien retourné vers le lagon après la ponte, en observant l’empreinte caractéristique de sa descente dans le sable.
Impossible de confirmer un acte de braconnage, mais chaque trace, comme celles laissées par un bateau sur la plage, est soigneusement examinée.
Si le cycle de ponte apparaît clairement dans le sable, c’est plutôt rassurant. Dans le cas contraire, cela peut signifier que la tortue a été victime de braconniers durant ce moment de grande vulnérabilité, qui peut durer plusieurs heures. Une tortue pond en moyenne entre 120 et 130 œufs, mais on estime qu’un seul d’entre eux atteindra l’âge adulte et deviendra reproducteur.
« Les braconniers arrivent aussi bien par la terre que par la mer. Ils peuvent dépecer la tortue sur place ou l’emmener vivante. Parfois, ils la retournent sur le dos et la laissent dans un coin de la plage avant de revenir plus tard. Il arrive même qu’ils la traînent sur le sable. Les traces laissées derrière permettent souvent de savoir qu’une équipe est active et utilise cette méthode », explique-t-il aux trois membres de l’association, attentifs.
Former les associations et les particuliers pour multiplier la surveillance du littoral
Makdouri, 19 ans, membre de l’association Le Regard du cœur, tient une tête de tortue dans sa main.
Ce n’est pas la première fois qu’ils participent à un suivi de braconnage avec Oulanga Na Nyamba, mais ils veulent approfondir leurs connaissances afin de pouvoir eux-mêmes organiser des sorties et transmettre ce savoir.
« Notre association était surtout axée sur le volet social, mais après le cyclone, nous avons décidé de nous engager dans la protection des tortues », raconte Ben-Abdallah. « Au nord, il y a peu de surveillance des plages. Notre directrice a donc lancé ce projet. C’est important que les jeunes sortent de leurs villages, découvrent leur environnement et comprennent qu’il faut le protéger ».
Ben-Abdallah, son frère Hicham et leur ami Makdouri espèrent un jour mener leurs propres bivouacs nocturnes pour empêcher les braconniers d’agir. Avec leur association basée à Longoni, ils ont déjà investi dans le matériel nécessaire, mais ils continuent de bénéficier de l’expertise d’Oulanga Na Nyamba afin d’être pleinement autonomes. L’association de Petite-Terre, opératrice du Réseau Échouage Mahorais de Mammifères marins et de Tortues marines (REMMAT), mise sur la mobilisation des bénévoles et d’autres structures locales à travers le territoire pour créer une véritable « chaîne d’alerte » et multiplier les yeux sur le littoral.
Depuis sa création à Mayotte il y a 25 ans, Oulanga Na Nyamba transmet ce savoir-faire et cette expertise. Mais, dans le contexte budgétaire actuel en France et après la crise provoquée par le cyclone Chido, leurs missions et leur travail ont été fortement impactés, au point que l’association a failli disparaître.
Repartir de zéro avec une diminution des financements
Makdouri, Ben-Abdallah et Hicham suivent un programme de formation auprès de François-Elie et Oulanga Na Nyamba pour acquérir les compétences nécessaires à la protection des tortues.
« On commence doucement à relever la pente, mais c’est comme repartir de zéro », confie François-Elie. « Beaucoup de nos projets se sont arrêtés après Chido, à cause des pertes de financement. À cela s’ajoutent les départs de nombreux salariés et, avec eux, leurs compétences : nous ne sommes plus que quatre employés, contre vingt-deux avant le cyclone ».
L’association n’avait pas de direction depuis septembre 2024, mais un nouveau directeur doit prendre ses fonctions début décembre. « Cela devrait donner un nouvel élan à l’association », espère-t-il. Mais les défis restent nombreux. « Je ne sais pas si notre projet de centre de soins et de découverte des tortues Ka’za Nyamba verra le jour », s’inquiète-t-il. Les travaux du centre qui devait être une sorte de « petit-frère » de Kélonia à La Réunion, ont commencé mais ils sont au point mort depuis plusieurs mois. « Nous avions un gros financement en négociation, mais il n’a pas abouti. Le projet devait être soutenu par le Département, l’État, la Communauté de communes de Petite-Terre et même un financement européen, mais ce dernier n’a pas été obtenu. Nous cherchons maintenant d’autres financeurs ».
« Nous faisons tout pour continuer à former, même si c’est plus difficile aujourd’hui. Nous avons perdu notre équipe de nuit et n’avons pas encore repris les sorties d’observation des pontes à Moya, une activité historique. Nous essayons de tirer du positif de cette situation, mais il nous faut retrouver des personnes de confiance, cela prendra du temps », poursuit François-Elie.
Chaque carcasse de tortue est signalée à la peinture pour éviter un double comptage.
Sur l’ensemble du territoire, de nombreux secteurs de la pêche à l’agriculture, en passant par la sécurité en mer sont en pleine structuration. D’autres, comme la santé, peinent encore à trouver des professionnels et nécessitent la mise en place de formations adaptées. Pendant ce temps, des associations bien établies et riches de l’expertise de leurs membres, comme Oulanga Na Nyamba, se retrouvent fragilisées.
Il est pourtant crucial de préserver ces structures et associations, et de ne pas les tenir pour acquises, surtout dans un contexte de coupes budgétaires nationales. Au-delà de la protection des tortues marines, cette situation illustre les difficultés à maintenir et soutenir le tissu associatif local. Négliger ces acteurs affaiblit durablement le territoire et laisserait un goût amer au moment de dresser le bilan de sa reconstruction.
Victor Diwisch