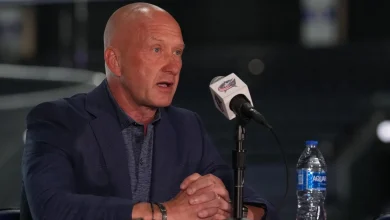30 ans après le référendum | La discrète préférence de Washington

Publié à 5 h 00
En 1995, le débat sur l’avenir politique du Québec ne faisait pas vraiment les manchettes à Washington. Il y avait bien quelques fonctionnaires qui suivaient cet enjeu, mais ils se montraient d’une discrétion exemplaire. Les journalistes canadiens en poste dans la capitale américaine n’avaient pas de très bonnes histoires à se mettre sous la dent.
Traditionnellement, l’administration américaine s’en tenait à une simple phrase pour exprimer sa position, une déclaration que les spécialistes des relations canado-américaines ont baptisée « mantra » : « Nous avons bénéficié d’excellentes relations avec un Canada fort et uni, mais il appartient aux Canadiens de décider de l’avenir du pays. »
Si le public américain en général ne se préoccupait guère du débat en cours au nord de sa frontière, quelques Américains au sein de l’administration s’y intéressaient, en tant que responsables des affaires canadiennes dans les organismes gouvernementaux à portée internationale, comme le département d’État, le département du Commerce ou la Commission du commerce international. Ils échangeaient fréquemment avec des spécialistes du Canada dans les grandes universités ou les instituts de recherche.
Ils étaient surnommés Canada Watchers, ou canadologues, par les journalistes canadiens en poste à Washington, qui suspectaient que les opinions exprimées par les universitaires et autres chercheurs donnaient une bonne idée des réelles positions des canadologues gouvernementaux, soit une préférence marquée pour l’unité canadienne.
Les politiciens canadiens et québécois qui ont visité Washington pendant l’année 1995 ont tenté de susciter un peu d’intérêt : le chef du Parti réformiste, Preston Manning, a comparé le mouvement souverainiste québécois à la guerre de Sécession, alors que l’ancien premier ministre du Québec Robert Bourassa a affirmé que les résultats du référendum du 30 octobre pourraient réserver des surprises. Ils s’adressaient toutefois à des instituts de recherche ou à des organisations de commerce bilatéral, à portée limitée.
C’est finalement à l’approche de la date du référendum que l’administration de Bill Clinton a révélé une préférence plus marquée pour l’unité canadienne et a légèrement modifié le fameux mantra.
« Je peux vous dire qu’un Canada fort et uni a été un merveilleux partenaire pour les États-Unis, et un citoyen constructif et incroyablement important à travers le monde », a déclaré le président américain quelques jours avant le référendum, lors d’une conférence de presse sur le budget américain.
« J’espère que ça va continuer ainsi. »
La présidence américaine n’a pas commenté les résultats le soir du 30 octobre.
Tractations pour poser une question
Le lendemain, les journalistes canadiens ont cherché à obtenir une réaction lors d’un évènement de presse, une conférence sur la Bosnie.
Or, il était extrêmement difficile pour un journaliste étranger de poser une question en conférence de presse. Selon la tradition, les journalistes des grands médias américains occupaient les premières rangées, en ordre d’ancienneté. Les journalistes canadiens ont donc demandé à la doyenne des journalistes, Helen Thomas, alors âgée de 75 ans, d’interroger pour eux le président au sujet du résultat référendaire. Ce qu’elle a fait gentiment.
Le président Clinton ne s’est pas étendu sur la question, mais il s’est dit heureux du résultat.
Les débats sur la souveraineté du Québec ont rapidement sombré dans l’oubli à Washington. L’exercice démocratique québécois a quand même attiré l’attention d’une personne : la fille du président Bill Clinton, Chelsea, alors âgée de 16 ans.
Chelsea Clinton a écrit une lettre sur le référendum québécois dans le journal de son école, un établissement privé appelé Sidwell Friends School. Elle y a souligné le taux de participation élevé, qui a dépassé 92 %, alors que seulement 55 % des électeurs avaient voté à l’élection présidentielle américaine de 1992.
« Je pense qu’il est déshonorant pour ce pays [les États-Unis], presque au point de l’hypocrisie, que les gens se précipitent aux feux d’artifice du 4 juillet, mais pas aux urnes le premier mardi de novembre », a déploré la jeune Chelsea dans sa lettre. « Il existe ici une paresse chronique et un rejet de l’utilité du vote dans le cœur de bien des Américains. »
Elle a ajouté que la ferveur des jeunes canadiens l’avait impressionnée encore davantage.
« Ils étaient impliqués et étaient intéressés à ce qui se passait autour d’eux. Ils ont agi selon leurs convictions. »
Quelqu’un, quelque part au département d’État, a discrètement envoyé un exemplaire du journal à l’ambassade du Canada, qui l’a discrètement transmis à un journaliste torontois.