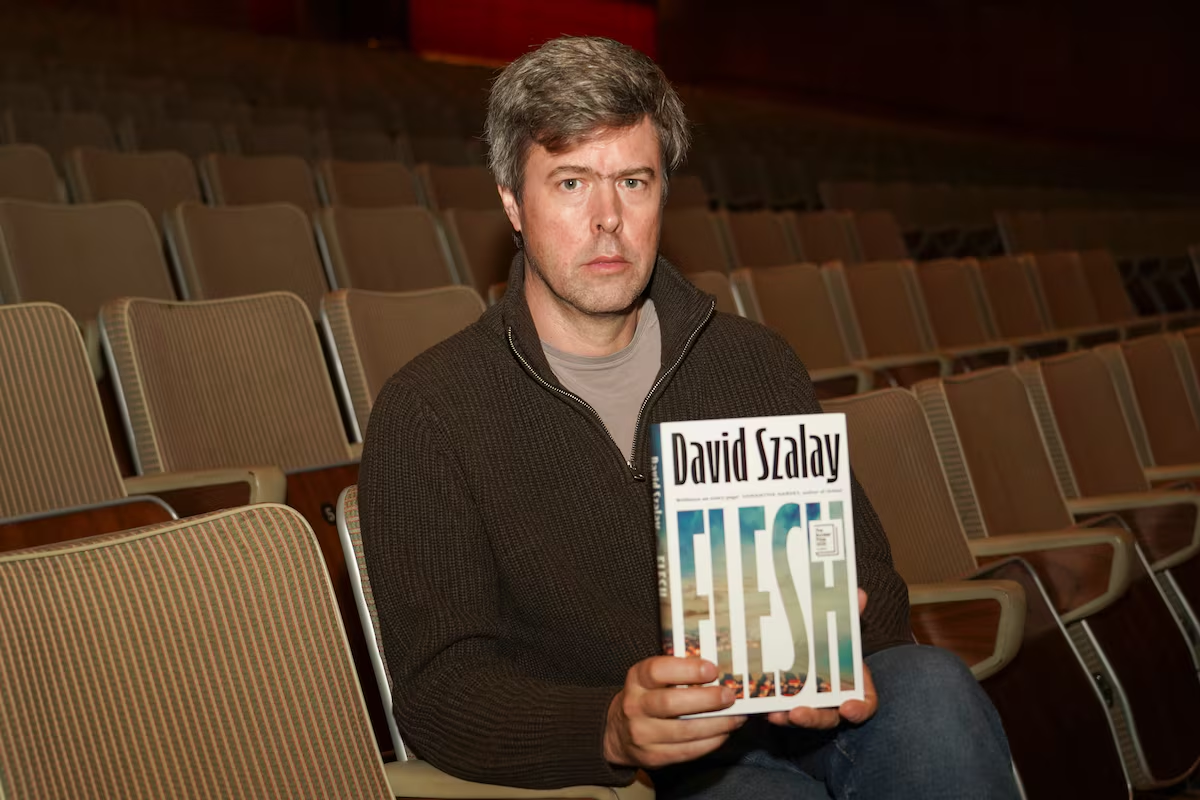L’éditorial de Marie-Andrée Chouinard | Les angles morts

La division des services essentiels du Tribunal du travail (TAT) a parlé. Non, les grèves subies par les usagers du métro et de l’autobus à Montréal ne risquent pas de mettre la sécurité ou la santé des citoyens en danger. Elles constituent un inconvénient, un léger embarras forçant la modification des habitudes, un « caillou dans le soulier », quoi. Mais quelle science inexacte sert donc à mesurer les impacts sur la santé et la sécurité des citoyens et comment isole-t-on les effets collatéraux invisibles sur les populations les plus vulnérables ? On dirait qu’il y a des angles morts qu’on ne veut pas voir.
À lire les décisions rendues par le TAT pour encadrer les services essentiels pendant la durée des grèves du transport collectif que subit actuellement Montréal, cette portion de la réflexion n’est pas essentielle. Oui, une grève doit entraîner un inconfort par sa nature même, sinon elle passe totalement à côté du rapport de force qu’elle tente de créer pour arriver à mieux négocier les conditions de travail. Mais pourquoi faut-il que ce soit toujours les mêmes populations qui encaissent les contrecoups ?
Samedi dernier, aucun autobus ne roulait sur les voies de la métropole et le métro était à l’arrêt, une première — invraisemblable — en 38 ans. Dimanche, jour de scrutin municipal, des services de transport en commun étaient assurés aux heures de pointe seulement. Sans règlement, il en sera ainsi jusqu’au 28 novembre, dans une ville qui compte 1,1 million de déplacements quotidiens sur son réseau. Dire que cette grève provoque un certain chaos relève de l’euphémisme.
À Montréal, dimanche, le taux de participation lors des élections s’est échoué à 35 %, une autre baisse. On ne saura pas l’effet de l’absence de transport collectif pendant les heures cruciales de vote sur ce taux famélique. Le TAT s’était rangé aux arguments des syndicats, qui ont plaidé que les effets indirects de la grève sur le taux de participation entraîneraient « des inconvénients très, très mineurs », et sans doute même pas « l’équivalent d’un caillou dans le soulier ».
Derrière la froideur des textes juridiques et des statistiques se cachent des réalités humaines déchirantes. Des personnes âgées incapables de se rendre à des rendez-vous médicaux. Des travailleurs à faible revenu ou des étudiants n’ayant pas le luxe du télétravail ni de quoi payer un Uber ou des taxis hors de prix. Des salariés aux horaires atypiques incapables de se coller aux horaires de pointe offerts par la STM. Des parents qui jonglent entre garderie, travail et obligations familiales. Des commerçants contraints de fermer boutique plusieurs heures par jour. Pour ces citoyens, la grève n’est pas un simple désagrément : c’est une crise qui compromet leur capacité même à fonctionner au quotidien. Quelques jours de ce régime peuvent être tolérables, mais un mois entier ? Allons donc !
Le TAT a conclu que les deux dernières grèves de juin et septembre dernier n’avaient entraîné aucun problème sur le plan de la sécurité et de la santé des citoyens, ce qui le conforte dans sa décision de donner le feu vert à cette troisième. Mais les « inconvénients » notés par le Tribunal calculent-ils, par exemple, une baisse de fréquentation des banques alimentaires, faute de transport pour s’y rendre ? Et qu’entend-on au juste par une mise en danger de la population et des risques pour la sécurité ? Faut-il parler de danger de mort imminente pour que le Tribunal se range à la raison ? Des rendez-vous médicaux perdus pour une personne en suivi de maladie grave, où cela figure-t-il dans le bilan des effets néfastes sur la santé et la sécurité des personnes ? Il semble qu’une large part de ces angles morts est occultée par les décideurs.
Il est vrai que le rôle du TAT est ingrat. Cette institution indépendante a la lourde responsabilité d’évaluer l’impact des grèves sur les services essentiels et de trouver un équilibre délicat entre différents droits fondamentaux. En 2015, la Cour suprême a souligné la protection constitutionnelle du droit de grève avec l’arrêt Saskatchewan. Le Tribunal doit déterminer si les services proposés pendant une grève sont suffisants pour éviter de mettre en danger la santé ou la sécurité publique.
Les employés de la STM sont-ils en train de faire la démonstration par l’absurde de la nécessité de la loi 89 (Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out) ? Adoptée cette année par le gouvernement du Québec, cette loi entrera en vigueur le 30 novembre prochain, deux jours après la fin prévue de l’actuel conflit. La loi permet au ministre du Travail d’intervenir pour exiger le maintien de services assurant « le bien-être de la population » lorsque la sécurité sociale, économique ou environnementale est menacée.
Certes, la loi 89 a suscité des critiques virulentes qui sont en grande partie justifiées. Mais il faut admettre que certains services sont si vitaux pour le bien-être de la population qu’ils ne peuvent être complètement interrompus, même en situation de conflit. Le transport en commun dans une métropole comptant 1,8 million d’habitants en est un. Sortir de cette impasse est impératif. Les deux parties doivent retourner à la table de négociation avec une volonté sincère de compromis.