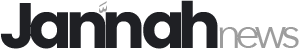Les livres de l’automne

Une histoire de familles
Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L, 560 p., 24 €
Kolkhoze, c’est le nom donné à ces fermes collectives soviétiques qui, comme elles étaient de statut coopératif, étaient considérées comme plus humaines que les fermes d’État, les sovkhozes. Hélène Carrère d’Encausse, née Zourabichvili, héritière d’une famille de Russes blancs dont le père fut éliminé à la Libération pour faits de collaboration et qui fut députée européenne RPR, avait également « la conviction étrange qu’un kolkhoze, c’était mieux qu’un sovkhoze ».
Kolkhoze, c’est aussi le nom qu’Hélène avait donné à ce rituel intime du dortoir partagé avec ses trois enfants – Emmanuel, l’aîné, l’auteur de ce roman familial, Nathalie, la cadette, avocate spécialisée en droit de la santé, et Marina, la benjamine, médecin et animatrice télé – quand leur mari et père Louis Carrère, dit Carrère d’Encausse par transformation en particule de la première lettre du nom de sa mère, Dencausse, était parti pour ses tournées d’inspection dans les agences locales d’un groupe d’assurance mutualiste.
Kolkhoze, c’est le dernier moment que les trois enfants ont vécu avec leur mère dans l’unité de soins palliatifs Jeanne-Garnier, quand, rassemblés autour d’elle, ils ont « pour la dernière fois fait kolkhoze ».
Kolkhoze, c’est le titre du dernier récit d’Emmanuel Carrère : un roman familial en forme de roman généalogique, une sorte de « matrohistoire », de « généhistoire », qui court sur plus d’un siècle en s’appuyant sur les recherches familiales du mari et du frère du personnage principal, la défunte secrétaire perpétuelle de l’Académie française, celle qui avait voulu imposer à l’encontre de l’usage populaire celui du féminin pour désigner la maladie qui nous a contraints au confinement.
Ni exercice d’admiration filial, ni matricide littéraire à la façon du Vipère au poing d’Hervé Bazin, c’est un récit profondément honnête que nous livre l’auteur de L’Adversaire et du Royaume, appliquant à l’histoire de sa mère, et en creux à celle de son père, ce qui fait sa méthode et son style inimitables, le dialogue entre la reconstitution historique et les résonances personnelles, voire intimes, qu’elle suscite ou avec laquelle elles s’entrecroisent.
Daniel Lenoir
Transmission
Guy Aurenche avec les Amis de Saint Merry Hors-les-Murs, L’Aventure hors les murs. L’esprit souffle où il veut, Éditions de l’Atelier et Temps présent, 144 p., 16 €
Né en 1975 dans l’église Saint-Merry, au cœur de Paris, le Centre pastoral Halles-Beaubourg fut longtemps un laboratoire spirituel. On y célébrait autrement, dans une liturgie inventive mêlant prêtres et laïcs, artistes et marginaux. Un christianisme urbain et parisien, habité par l’esprit de Vatican II et de Mai 68, prenait chair dans ce lieu ouvert à toutes les fragilités. À Saint-Merry, on accueillait les exclus : personnes LGBTQ+, prostituées, malades du sida.
En 2021, l’archevêque de Paris, Mgr Aupetit, mit fin un peu brutalement à cette expérience, invoquant des tensions internes et un climat devenu délétère. Mais Saint-Merry n’est pas mort. Il s’est réinventé « hors les murs » – référence à l’enterrement de Paul hors les murs à Rome – dans un espace à la fois spirituel et numérique : site Internet, rencontres Zoom, engagement dans le « chemin synodal » voulu par le pape François. Aujourd’hui encore, la communauté, reconnue par Mgr Laurent Ulrich, affirme vouloir « vivre en communion dans la diversité ».
Ce livre collectif retrace cette histoire singulière. Les auteurs y évoquent la créativité liturgique et l’audace pastorale d’un lieu souvent marginalisé par le diocèse dans les années Lustiger. En parallèle, ils interrogent la portée spirituelle du terme « hors les murs » : déplacement, itinérance, inconfort fécond. L’ouvrage mêle récit, théologie, exégèse, psychanalyse et même cinéma et arts plastiques – une diversité parfois inégale, mais toujours stimulante.
Certains témoignages marquent par leur intensité, comme celui de Jean-Louis Lecouffe, parlant sans fard de maladie, de sexe et d’addiction : une foi incarnée, charnelle, parfois douloureuse. D’autres textes, plus lyriques, tendent à idéaliser Saint-Merry comme une communauté fondatrice, « instrument de vie indispensable ». L’une des contributrices ose cette formule troublante : « Quitter l’Église après Saint-Merry, ce serait se quitter soi-même. » Vraiment ? Que faire pour être chrétien si on n’a pas la chance d’avoir connu un tel lieu ?
Au fond, ce livre est un mémorial, générationnel sans toujours le dire, d’un catholicisme qui a cherché à respirer autrement. Les auteurs refusent d’en faire un patrimoine, fidèles à l’esprit d’invention libertaire des origines. Mais comme le rappellerait la sociologue Danièle Hervieu-Léger, croire, c’est aussi toujours se rattacher à des générations de croyants. Entre lyrisme et lucidité, L’Aventure hors les murs invite à réfléchir à ce que l’on transmet : non une nostalgie, mais un souffle, toujours en mouvement. Et si ce livre permettait de transmettre entre générations de chrétiens l’ouverture en direction des plus jeunes et de leur cri pour plus de justice ?
Anthony Favier
« Ayez pitié, Monsieur le Président. »
Mariann Edgar Budde, Apprendre le courage. Les moments décisifs de la vie et de la foi, Flammarion, 304 p., 22,50 €
Mariann Edgar Budde, est l’évêque qui, lors de l’homélie du service religieux de l’investiture de Donald Trump, avait demandé au Président de faire preuve de compassion envers ceux qui ont peur et craignent pour leur vie. Cet acte de résistance la fit connaître du monde entier. Dans Apprendre le courage, elle raconte ces moments décisifs de la vie, désirés ou subis, où il est nécessaire : le courage de partir, de changer, mais aussi celui de rester, de s’enraciner plus profondément dans ce que nous avons choisi. Elle reconnaît la peur, mais elle montre aussi qu’il est possible d’avancer malgré elle. Mariann Budde émaille son ouvrage d’exemples autobiographiques et de références bibliques, mais fait aussi appel à de grandes figures spirituelles ou humaines. Elle montre que le courage n’est pas seulement un grand moment héroïque, mais un défi quotidien, une série de petits choix, parfois silencieux, que nous faisons chaque jour. Entre témoignage personnel et essai spirituel, un livre où il fait bon cheminer.
Estelle Roure
L’éternel retour des hérésies
Denis Moreau, Tous hérétiques ? Sur l’actualité de quelques débats chrétiens, Seuil, 336 p., 23 €
Philosophe catholique, Denis Moreau défend dans son dernier livre une thèse qui n’a rien de très original : loin d’être des doctrines mortes, les hérésies qui ont ponctué l’histoire du christianisme continueraient de se manifester de manière plus ou moins explicite, sous forme de « résurgences », et ce dans le champ de l’Église aussi bien que dans les sphères intellectuelles séculières.
L’idée même d’hérésie semble connaître depuis plusieurs décennies une vague de sympathie, associée à l’idée de « minorité » ou de « dissidence » : « Le moderne aime s’autodéfinir en rebelle et jouir de sa (présumée) singularité. » Denis Moreau s’attache à condamner clairement la violence exercée par l’Église à l’encontre des hérétiques à travers l’histoire – certes exagérée par une « légende noire » anticléricale entretenue depuis Jules Michelet, qui chiffrait à plusieurs millions les victimes de l’Inquisition, alors que l’historiographie actuelle s’accorde plutôt sur quelques milliers. « Il est en revanche moins évident, juge le philosophe, que l’Église ait toujours eu tort de condamner les idées véhiculées par certaines hérésies. »
Sans prétention à l’exhaustivité, il s’arrête sur plusieurs courants hérétiques, parmi les plus influents, pour les mettre en parallèle avec des tendances intellectuelles contemporaines. Ainsi, le marcionisme, qui veut rompre avec un Dieu de l’Ancien Testament « animé par un rigide voire colérique souci de justice, imposant de façon intransigeante sa Loi au moyen de commandements » au profit du Dieu miséricordieux du Nouveau Testament, ressurgirait aussi bien dans une version « réactionnaire » dans les milieux intégristes où persiste l’antijudaïsme chrétien, que dans une version « progressiste » chez des « chrétiens d’ouverture », qui, voulant se débarrasser trop vite de l’antique Loi, se priveraient de la « portée structurante de l’interdit » (Sigmund Freud).
L’exercice trouve malheureusement sa limite dans l’absence de hiérarchisation des exemples mobilisés. En matière de résurgences gnostiques, caractérisées notamment par un rejet du corps, ainsi qu’un culte du secret et de l’initiation, la critique du genre formulée par Judith Butler se retrouve mise sur le même plan que la doctrine mystico-sexuelle des frères Philippe, fondateurs de la Communauté Saint-Jean, qui a justifié une emprise spirituelle et des violences sexuelles à grande échelle.
Timothée de Rauglaudre
Indignons-nous !
Roselyne Bachelot, Une omerta française. Secrets d’enfance, Plon, 240 p., 20,90 €
En lisant Une omerta française. Secrets d’enfance, on comprend pourquoi Roselyne Bachelot avait immédiatement soutenu la pétition de Témoignage chrétien lancée à l’automne 2018 pour réclamer la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur la pédocriminalité dans l’Église catholique – dont le refus a conduit à la création de la Ciase.
Elle y raconte d’abord comment, jeune élève d’une école privée catholique, elle avait été protégée d’« un ratichon lubrique » grâce à la vigilance d’une mère qui avait elle-même été confrontée, au même âge et dans une école catholique, à la pédocriminalité ecclésiastique – une de ses amies, enceinte d’un prêtre ami de la famille, s’était suicidée. Cet événement lourd de la mémoire familiale ouvre une réflexion indignée qui s’appuie sur son expérience d’élue locale, de parlementaire, de ministre et de personnage public, mais aussi d’enfant, d’élève, de mère, de pharmacienne et de bénévole dans des associations caritatives et culturelles. Une indignation qui ne vise pas que la pédocriminalité mais aussi tous les autres crimes sexuels « couverts par une hiérarchie ivre de corporatisme et d’orgueil » ; une indignation alimentée par la révolte de voir ses « amis atteints du sida désignés comme punis pour un péché imaginaire » et, plus généralement, par « une homophobie hypocrite » – elle fut l’une des rares parlementaires de droite à voter pour le Pacs et le mariage pour tous – ; une indignation nourrie de l’humiliation devant « le pouvoir des clercs dans l’Église », la place minorée qu’y tiennent des femmes qui ne seront « jamais traitées à l’égale des hommes ». Elle explique aussi son refus des « manipulations pratiquées [par les clercs] sur ceux qui font les lois de la République » et dont elle a été elle-même l’objet dans son Maine-et-Loire natal et catholique, « fief de la démocratie chrétienne », ainsi que son attachement à une laïcité « garante de la démocratie » face au « délire obsidional et [à] la conviction » de nombre d’institutions catholiques « que les lois de la République [sont] opposées aux valeurs chrétiennes ».
C’est le texte d’une agnostique, « pas assez prétentieuse pour se déclarer athée », qui sait toutefois profondément ce qu’elle doit à l’Église catholique, au point d’en revendiquer les valeurs – sur lesquelles celle-ci s’est assise. Un réquisitoire vivant et documenté, dans son style inimitable, à la mesure de la déception qu’elle a vécue.
Daniel Lenoir
Cassandre
Constance Rivière, L’Incendiaire, Stock, 256 p., 20,50 €
« Je parle, je parle… et personne ne m’écoute ». Alexandra est une héroïne des plus respectables : de très belles études, un parcours professionnel imposant et le retour « au pays », pour travailler dans l’entreprise de chimie de la ville dont son père est maire. Elle va découvrir des manquements aux normes de sécurité qui pourraient mener à une catastrophe écologique. Mais le directeur de l’usine, ses collègues, sa propre famille ignorent ses alertes. Sa vie bascule petit à petit : plus elle essaye d’attirer l’attention sur sa découverte, plus elle est ostracisée ; mais sa volonté redouble : elle ne peut se taire, convaincue, à juste titre, que la vérité qu’elle détient est importante pour la ville et ses habitants. Un roman enquête journalistique implacable habité par la figure mythique de Cassandre, celle dont la malédiction est de ne pas être entendue et crue. L’autrice, qui a enquêté sur les lanceurs d’alerte, décrit parfaitement les mécanismes de culpabilisation (« Tais-toi ! Tu ne veux pas faire fermer l’usine ! »), d’ostracisation sociale (« Elle est folle ! ») et de mise au placard dans l’entreprise. Elle met en avant les enjeux économiques et politiques, les jeux de pouvoir et de domination. Mais Constance Rivière insiste particulièrement sur la façon dont la parole des femmes lanceuses d’alerte est perçue et reçue : une parole faible, inaudible, ou alors « hystérique » ou « émotionnelle » ; une parole qui n’est donc ni écoutée, ni entendue.
« Quand les sirènes des pompiers ont remplacé le silence de la nuit, quand j’ai senti leur présence d’hommes, je suis partie. J’ai fui sans me retourner. Puisque parler n’avait servi à rien, mes mots mêmes auraient pu se retourner contre moi. Après avoir ignoré mes avertissements, il s’en trouverait bien pour m’en vouloir de ne pas avoir été assez convaincante. Ou pour faire de moi la coupable, l’incendiaire. »
Estelle Roure