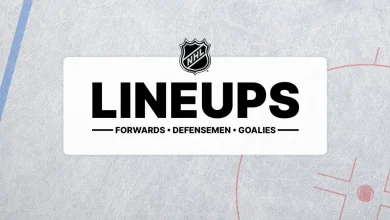D’où vient l’accent québécois ?

Les quelque 2 000 aînés qui ont rédigé leur autobiographie, répondant à l’appel de Janette Bertrand dans le cadre de son projet Écrire sa vie, risquent fort de se reconnaître dans Cent ans d’histoire : Vous m’avez raconté le Québec. Des récits de ceux qu’elle nomme « les biographes », la grande dame a retenu les thèmes principaux — la religion, la famille, le patriarcat, la médecine, etc. — pour les explorer par le truchement de ses propres expériences.
Dans cet extrait, Janette Bertrand parle de sa perception du « bon français ». Laurent Turcot explique pour sa part, dans la section « Un peu de contexte », d’où vient l’accent (ou les accents) québécois, et comment il a évolué.
J’ai été surprise de la qualité du français des biographes. Dans les capsules que j’ai faites pour le projet Écrire sa vie, je disais : « Les fautes, c’est pas grave. Il faut que ça vienne de l’intérieur. Que ça vienne de vos tripes. Les fautes, il y a toujours quelqu’un pour les corriger. Vous pouvez demander à votre petit-fils de les corriger. » Et il y en a eu, des fautes. Mais pas tant que ça ! J’avais le préjugé — je dis bien le préjugé — que le monde ordinaire ne pouvait pas écrire. Je me suis trompée. Il faut dire que, étant dyslexique, je me demande encore pourquoi j’ai choisi d’écrire, puisque je fais de nombreuses fautes.
Quand j’étais jeune, un mélange de vieux français et d’anglais formait notre langue parlée. On parle mieux notre langue aujourd’hui que le faisait la génération de mon père. On sentait encore l’héritage de la Conquête, quand les Anglais ont pris possession de la Nouvelle-France et nous ont forcés à parler leur langue, la langue du conquérant. Au lieu de s’angliciser, les Canadiens français ont fièrement gardé leur langue, et c’est grâce à eux si on la parle encore. C’est grâce à la ténacité de nos aïeux, à leur résilience, qu’on a pu conserver cette richesse. Merci à nos grands-parents et à nos parents !
~
Je suis allée en France pour la première fois en 1950, cinq ans après la fin de la guerre. On est partis, Jean Lajeunesse, Jean Gascon, Jean-Louis Roux, moi, et toute une bande. On allait découvrir notre mère patrie. La France était présente dans l’éducation des artistes !
On était comme des enfants abandonnés qui avaient hâte de retrouver leur mère. On l’avait tant glorifiée. Elle n’avait que des qualités. Je ne pense pas que les jeunes d’aujourd’hui soient tant attirés par la France. Ils vont partout ailleurs. Mais nous, jeunes Canadiens français, dès qu’on avait un peu de sous, on allait en France retrouver nos racines. On a pris l’avion pour l’Angleterre parce qu’il y avait des lits dans l’avion. À cette époque, ce n’était pas cher. Et la France non plus. Rendus là-bas, on a vu les ruines de bâtisses détruites par les bombes. Et c’était gris. Les belles rues et les édifices étaient couverts de suie. Ça a été nettoyé petit à petit.
C’est en France que j’ai réalisé que je n’avais pas de vocabulaire, mais surtout que je n’avais pas la réplique facile. À Paris, je vais acheter des timbres au bureau de poste et je fais la file. Devant moi, il y a une dame assez costaude qui m’empêche de voir la longueur de la file. Alors je me penche pour vérifier.
J’ai dû lui toucher le bras, car elle s’est retournée et m’a engueulée. J’ai fondu. Je n’avais pas l’agressivité verbale qu’ont si facilement les Français. Et je n’ai pas pu répondre. J’ai été très marquée par cet incident. Comment ça se fait qu’on n’a jamais le mot juste, qu’on s’exprime en disant : « C’est une affaire, c’est une chose, passe-moi la patente… » ? Depuis ce temps, je ressens beaucoup de fierté quand, à chacun de mes passages en France, j’apporte des québécismes, que je leur sers avec fierté. Et ils adoraient notre accent. Déjà, en 1972, on commence la diffusion de Quelle famille ! partout en France. C’était la première émission québécoise diffusée dans la francophonie. Elle jouait tous les soirs de la semaine à 19 h 30. Curieusement, ils comprenaient tout.
À lire aussi
UN PEU DE CONTEXTE
Les colons français sont arrivés en Nouvelle-France avec des accents du Poitou, de l’Île-de-France, de Paris, de Bretagne, mais surtout de Normandie. La langue commune est le français, qu’on parle assez bien, d’autant plus qu’on l’appelle « la langue du roi » et que c’est la langue de l’administration et de l’armée.
À la suite de la Conquête britannique, le lien avec la France est rompu. Puis, dans les années 1790, la langue subit des réformes en France. La prononciation change, alors que les Canadiens français conservent une prononciation similaire à celle de la métropole française au 18e siècle. L’accent propre à la colonie se développe.
Après les rébellions des Patriotes, l’Angleterre envoie lord Durham pour enquêter sur les événements récents dans la colonie. Celui-ci dira que les Canadiens français sont un peuple sans histoire, qu’il faut assimiler le plus rapidement possible. Les Anglais, dont Durham, estiment que le français parlé dans la colonie n’est, de toute façon, pas un « vrai français », mais plutôt un « French Canadian patois ». Plusieurs sont piqués au vif par le rapport Durham, dont un ecclésiastique et linguiste, Thomas Maguire, qui déclarera qu’il faut parler le français comme les Français. C’est alors que vont se renforcer deux registres de langue.
D’un côté, le registre de langue châtiée, « pincé », puis, de l’autre, celui du peuple. Dans la langue populaire, les emprunts à l’anglais sont fréquents. Par exemple, on disait « orge » en Nouvelle-France, mais, avec l’arrivée des colons et des marchandises britanniques, le terme qui s’impose est celui qu’on voit sur les sacs d’orge : barley. On peut donc entendre : « Je vais prendre la soupe au barley. » Cette langue commence à être intégrée au parler courant. Peu à peu, au 19e siècle, l’Église, qui considère que la langue est gardienne de la foi, propage l’idée que les Canadiens français parlent mal, une « vieille langue », et qu’ils sont contaminés par l’anglais. Au fil du temps, les Canadiens français commencent à avoir honte et à éprouver, comme l’ont expliqué Anne-Marie Beaudoin-Bégin et Benoît Melançon, de l’insécurité linguistique.
Laurent Turcot, historien
Finalement, à cette époque, on est convaincus qu’on ne sait pas parler. On nous le répète assez souvent ! Pourtant, ce qui fait que le Québec va se constituer en une province unique et spécifique, c’est la langue française. On est fiers, d’un côté, de parler français, parce que ça nous distingue des autres, mais par rapport à la France, on se sent très inférieurs. Mais ça a changé depuis ma jeunesse. Avec la mondialisation et l’ajout de mots anglais dans la langue des Français, on voit que notre langue à nous, au Québec, résiste encore et toujours.
À lire aussi
Cent ans d’histoire : Vous m’avez raconté le Québec, de Janette Bertrand, en collaboration avec Laurent Turcot, Libre Expression, 2025, 216 p. En librairie dès le 22 octobre 2025 (27,95 $).
Extrait publié avec l’autorisation de l’autrice et de la maison d’édition.