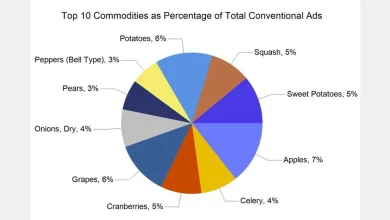Le facteur humain | Quelle est l’empreinte des voitures hybrides ?

D’abord destinée à n’être qu’une solution transitoire pour la décarbonation des transports, la voiture hybride demeure populaire auprès des automobilistes québécois. Du point de vue environnemental, comment se compare-t-elle aux autres types de voitures ?
Publié le 21 novembre
À la suite d’un article publié en septembre sur la performance environnementale de la voiture électrique 1, une lectrice nous a interpellés sur les voitures hybrides. « Pour une utilisation surtout urbaine, y a-t-il des raisons en faveur de son utilisation ? », demande-t-elle.
Pour les voitures électriques, le consensus scientifique est clair : dans plusieurs pays, y compris le Canada, elles émettent moins de gaz à effet de serre (GES) sur leur durée de vie que les voitures à essence, même en tenant compte de la production des batteries.
Les voitures hybrides combinent un moteur à combustion interne et un moteur électrique, une technologie qui retarde la nécessaire sortie des énergies fossiles aux yeux d’organisations environnementales comme Greenpeace.
Elles sont toutefois munies d’un système de batteries plus léger que celui d’un véhicule électrique, ce qui diminue les émissions associées à leur production.
Il existe deux types de voitures hybrides : la non rechargeable (HEV) et la rechargeable branchable (PHEV). La première ne se branche jamais sur le réseau électrique. Sa batterie se recharge principalement lors du freinage pour permettre au moteur électrique de soutenir le moteur à combustion, ce qui entraîne une économie d’essence.
La voiture hybride rechargeable, qui doit être branchée à une borne de recharge ou une prise domestique pour recharger sa batterie, permet de rouler en mode entièrement électrique sur une distance allant de 60 à 90 kilomètres selon les modèles.
Entre les deux
Anne de Bortoli et Susie Ruqun Wu, chercheuses au Centre international de référence sur l’analyse du cycle de vie et la transition durable (CIRAIG), se sont penchées sur l’empreinte des voitures hybrides dans le cadre de l’élaboration d’un calculateur pour les municipalités.
Leur constat : au chapitre de l’empreinte carbone, un véhicule électrique s’en tire mieux qu’un véhicule à combustion et les voitures hybrides se situent… entre les deux.
Alors qu’une voiture électrique génère de 60 % à 80 % moins d’émissions de GES qu’une voiture à combustion (sur une durée de vie de 300 000 km pour un véhicule municipal), la réduction est de 30 % à 50 % pour les voitures hybrides dans le contexte québécois, indique Susie Ruqun Wu.
Dans les autres catégories prises en compte par les analyses du CIRAIG (impact sur la biodiversité, dommage à la santé humaine, utilisation des ressources minérales), les voitures hybrides se situent aussi entre la voiture électrique et la voiture à combustion. L’hybride rechargeable fait mieux que l’hybride non rechargeable, sauf dans la catégorie des ressources minérales puisque sa batterie est plus grosse.
« Les véhicules hybrides non rechargeables permettent de réduire la consommation de carburant d’environ 20 %, souligne Anne de Bortoli. C’est une bonne chose, mais ce n’est pas aussi efficace que de passer à un véhicule rechargeable que vous utiliseriez principalement en mode électrique. »
Ce qui n’est souvent pas le cas dans la réalité, a constaté l’organisme britannique Transport & Environment.
Son analyse des compteurs de 800 000 voitures montre une surestimation de la part du mode électrique dans les données officielles. Celles-ci considèrent que les hybrides rechargeables sont propulsés par l’électricité 84 % du temps. En réalité, c’est 27 %.
« C’est assurément un drapeau rouge », affirme Susie Ruqun Wu. Dans une analyse de cycle de vie, la part de l’électrique prise en compte est habituellement de 50 %.
Derrière l’« écran de fumée »
Transport & Environment qualifie la voiture hybride rechargeable d’« écran de fumée ».
Luc Gagnon, consultant en énergie, transport et environnement, n’est pas d’accord. Il estime qu’un automobiliste qui parcourt le plus souvent de courtes distances pourrait pratiquement n’avoir jamais besoin d’essence, ce qui ferait de l’hybride rechargeable un meilleur choix qu’une voiture électrique.
« J’en suis convaincu », martèle-t-il.
Avec de toutes petites batteries, presque 10 fois plus petites [que celles des voitures électriques], on peut faire peut-être 80 ou 90 % de l’électrification.
Luc Gagnon, consultant en énergie, transport et environnement
Il souligne qu’il existe des différences dans la technologie hybride, d’où l’importance de regarder attentivement les spécifications avant de faire un choix. Le poids des véhicules est aussi à considérer.
Une analyse de cycle de vie réalisée par le CIRAIG sur l’impact climatique des modèles de voitures les plus courants au Québec montre que, sur une durée de vie de 200 000 km, la Toyota Prius (PHEV) émet 100 g d’éq. CO2 par kilomètre comparativement à presque 180 g pour le Mitsubishi Outlander (PHEV). La Prius non rechargeable : 250 g d’éq. CO2 par kilomètre.
Il faut noter que ces analyses n’offrent pas une précision parfaite. La durée de vie des batteries crée de l’incertitude, tout comme la décarbonation future de la production électrique mondiale qui est parfois prise en compte, parfois non.
Luc Gagnon juge irréaliste la durée de vie de 300 000 km qui est souvent prise en compte dans ce type d’études, considérant que les voitures roulent en moyenne 15 000 km par année au Québec. Critique face aux subventions des véhicules électriques, il estime que ceux-ci s’ajoutent au parc automobile des ménages et ne contribuent pas à diminuer la congestion routière.
Ainsi, comme pour la voiture électrique, les mêmes questions se posent avant de considérer l’achat d’une voiture hybride : ai-je vraiment besoin d’une voiture ? Si oui, ai-je besoin d’une aussi grosse voiture ?
Le point sur les subventions
Les subventions fédérales pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable sont suspendues pour une durée indéterminée. Au Québec, le programme Roulez vert offre une subvention allant jusqu’à 4000 $ pour un véhicule électrique et 1000 $ ou 2000 $ pour un hybride rechargeable. Les sommes baisseront à compter de janvier. Le programme prendra fin le 31 décembre 2026.
Précision
Une version précédente de l’article omettait d’indiquer que la durée de vie prise en compte dans l’analyse de cycle de vie réalisée par le CIRAIG sur l’impact climatique des modèles de voitures les plus courants au Québec est de 200 000 kilomètres. La critique formulée par Luc Gagnon ne vise pas spécifiquement cette étude.
1. Consultez l’article « “Arnaque écologique”, la voiture électrique ? »