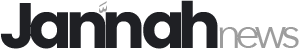Chronique de Maire Hélène Poitras | Les gens qui lisent dans le métro sont beaux

Ça fait déjà pas mal de bruit depuis quelques jours : la grève de la Société de transport de Montréal (STM) fragilise l’accès aux nombreux événements culturels en cours. Sans une entente, on en aura pour tout novembre. Le Coup de cœur francophone, la première édition du festival de théâtre jeunesse La mèche courte et le festival de films francophones Cinemania figurent au nombre des rendez-vous qui pâtiront des mesures d’arrêt partiel du service cette semaine.
On se souvient que le Grand Prix a été en quelque sorte « protégé » cet été. Et même si cette exception se justifie en partie par des raisons de sécurité par rapport au nombre d’usagers en circulation et au fait que les courses aient lieu sur une île peu accessible autrement qu’en métro, la comparaison fait grimacer. Cette fois, personne ne sera épargné. Et novembre est un gros mois, culturellement. L’impact d’une grève de la STM se fera sentir sur les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, les concerts de Paul McCartney, M pour Montréal et le Salon du livre.
Le conflit de travail à la STM compromet sérieusement l’accès du public, des élèves et des professionnels à cette célébration de la lecture, qui n’est pas un divertissement comme les autres. Les principales associations du milieu du livre ont rendu publique samedi une lettre ouverte appelant les parties prenantes à trouver une issue au conflit.
Depuis toujours — depuis que je lis —, je me rends au Salon du livre de Montréal en transport en commun. Quand je reviens chez moi, j’aime observer les lecteurs prendre place dans le wagon puis s’empresser de fouiner dans leur sac pour ouvrir les pages des trésors rapportés. Un petit pli au milieu des sourcils, absorbés dans leur lecture, transportés ailleurs dans l’espace et le temps, les gens qui lisent dans le métro sont beaux.
De novembre 1978 à novembre 2019, le Salon du livre de Montréal a eu lieu dans le hall d’exposition de la place Bonaventure. Vous souvenez-vous de l’odeur de brioche à la cannelle qui envahissait nos narines au sortir de la station Bonaventure quand on approchait de la billetterie ? Je me rends compte que cette odeur à la fois réconfortante et un peu écœurante, que j’avais malgré moi associée à la fête du livre, me manque presque depuis que l’événement se tient au Palais des congrès, station Place-d’Armes. Par contre, je trouve l’endroit plus convivial et accueillant avec ses gros tapis moelleux, sa forêt d’arbres roses — une installation de Claude Cormier intitulée Nature légère — et la belle lumière multicolore des fenêtres hautes près des escaliers roulants qui donnent sur la place Jean-Paul-Riopelle.
Je me souviens de la fois où je suis revenue du Salon avec Outrenuit, du poète Benoit Jutras, sous le bras, lecture savourée dans le cocon du wagon au rythme d’un poème par station, en synchronie parfaite. De la fois où, alors que j’étais à la maîtrise en études littéraires, je m’étais rendue au Salon du livre de Montréal avec un objectif précis en tête : rencontrer Anne Hébert, dont j’étais convaincue d’être la plus grande admiratrice. Nerveuse, je n’avais pas su trouver le courage de faire la file pour aller lui parler et m’étais contentée de l’espionner derrière un rayon de romans. Déçue de moi-même et rongeant mon frein dans l’autobus, incapable de me concentrer sur ma lecture — la Déclaration universelle des droits de l’homme, dénichée au Salon du livre —, je m’étais déclaré à moi-même que, si je remettais un jour les pieds au Salon, ce serait comme écrivaine, une promesse que j’ai tenue.
Je me rappelle la fois où, sept ans plus tard, en 2006, j’y suis retournée, enceinte et invitée d’honneur. On m’avait assise à côté de Monique Proulx. Souvenir d’un moment de grande fierté pour la jeune écrivaine et mère en devenir que j’étais. En sortant du métro, station Laurier, j’avais été prise d’une fringale de patates frites, que j’avais dévorées d’une main, un recueil de nouvelles dans l’autre.
Je me souviens de la fois où j’ai décidé d’y aller à vélo, du soleil givré dans le ciel pâle de novembre — il faisait froid et je m’étais gelé le bout des doigts. De celle où j’ai voulu m’y rendre en voiture, et où j’avais constaté à quel point c’est une mauvaise idée, on ne m’y reprendrait plus. Des sorties pédagogiques au primaire, avec les pantalons d’hiver qui font frouiche-frouiche dans les allées, et d’Ani Croche dans la main, acheté avec mon argent de poche.
Je me rappelle, il y a deux ans, d’avoir rapporté dans le métro bondé à l’heure de pointe un délicat plant d’orchidées, cadeau de mon éditeur. De l’avoir protégé de la foule presque comme si je tenais un bébé dans mes bras… malgré le sort qui l’attendrait une fois chez moi.
Depuis toujours, je vais au Salon du livre de Montréal en autobus ou en métro. De la musique dans mes oreilles à l’aller, un livre dans les mains au retour. Transportée en commun : c’est la manière intelligente et pratique de s’y rendre.
Je pense à tous les lecteurs qui seront privés de ce mode de locomotion, en particulier aux élèves d’écoles publiques pour qui des journées scolaires ont été préparées avec soin par l’équipe de programmation, aux bénévoles, aux auteurs qui, après des années à plancher sur un livre, rateront le rendez-vous avec une partie de leur lectorat, aux lecteurs qui décideront peut-être de rester chez eux. Je pense à tous les acteurs de la chaîne du livre qui, année après année, participent au salon même s’ils y perdent de l’argent. Ils y vont pour s’enrichir des rencontres qu’on y fait et permettre à la magie des mots d’opérer.
La littérature existe dans l’union entre celles et ceux qui écrivent et les autres qui les lisent. C’est quand les yeux d’un lecteur se posent sur les mots d’un écrivain que les histoires s’animent. Les principales associations du milieu du livre se sont mobilisées pour appeler les parties à trouver une issue au conflit. On ne peut que souhaiter que leur message soit entendu et que le gros bon sens l’emporte… à temps.